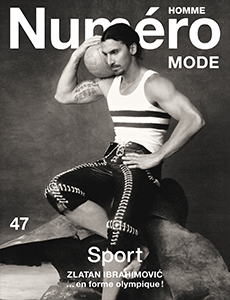Stuart A. Staples en live à la Fondation Cartier le 29 novembre 2021.
Numéro : Même si vos créations peuvent paraître s’en éloigner, la pop music demeure votre référence ultime. Que représente-t-elle pour vous ?
Stuart A. Staples : J’étais un gamin à la fin des années 70. Et je ne pourrai jamais y échapper. Je veux dire que si le punk-rock n’était pas apparu, je n’aurais jamais commencé à faire de la musique. Auparavant, la musique était assez technique, il fallait “savoir chanter” ou avoir appris à jouer correctement d’un instrument. Le punk-rock a permis à toute une génération de prendre conscience qu’il était possible de faire de la musique sans cette technicité. Ian Curtis [de Joy Division] en est le parfait exemple. Il ne savait pas vraiment chanter. Et il n’essayait pas. Il transcendait ça en exprimant le diamant enfoui au plus profond de lui. Je ne savais pas chanter, et il m’a montré que l’on pouvait tout de même le faire. David Boulter, Neil Fraser [les deux autres membres de Tindersticks] et moi avions 16-18 ans quand nous nous sommes rencontrés. Nous venions tous les trois d’un milieu populaire. Et nous vivions tous à Nottingham où le seul horizon pour des enfants d’ouvriers était de finir à la mine, à quelques kilomètres de là. Très peu allaient à l’université. Pour échapper à ce destin, il n’y avait que le football et la musique, grâce au punk-rock. Tous les jeudis, des familles entières se réunissaient dans toute l’Angleterre autour de la télévision pour regarder Top of the Pops [émission musicale culte de la BBC]. On regardait et on se disputait à propos des prestations. C’est la première fois que l’on voyait Brian Ferry ou David Bowie. Il n’était question que d’expression de soi. Avoir une chance de s’exprimer : c’était aussi important pour moi que pour Marc Almond [de Soft Cell] ou Kevin Rowland [de Dexys Midnight Runners] ailleurs en Angleterre.
Vos morceaux forment des espaces au sein desquels se déploie un sentiment singulier et une atmosphère. Vous les exacerbez comme pour en percer la vérité. Où ces atmosphères et ces sentiments trouvent-ils leur origine ?
Je ne peux écrire qu’à partir d’un sentiment que je ressens au plus profond de moi. Je suis incapable d’écrire pour les autres, de m’inspirer de leur vie ou du monde extérieur. Chaque chanson trouve son origine dans un moment, une temporalité particulière et une émotion qui y est associée. Une fois que j’ai décelé cette émotion, deux choix s’offrent à moi: l’accepter et lui laisser dicter le morceau, ou bien l’abandonner si je ne suis pas capable de lui laisser le pouvoir. Pour moi, la musique n’a jamais consisté à chanter, mais à créer cet espace à travers un morceau. Dans notre dernier album [Distractions, 2021], les deux premiers vous font passer d’un espace oppressant, d’un état de claustrophobie, à un lieu plus ouvert. J’aime travailler les morceaux à travers ce type de relations. Quand vous ressentez quelque chose au fond de vous, ce sentiment ouvre un espace que vous devez à la fois nourrir et satisfaire. La question d’ajouter une guitare acoustique ou des cordes est secondaire. L’enjeu est de savoir pourquoi je souhaite faire ce morceau. Quelle est la force qui m’y ramène ? Mais le morceau doit aussi être ouvert à celui qui l’écoute. Ce ne peut pas être un endroit réductible à un sentiment exclusivement personnel et que je pourrais décrire en seulement quelques mots. Il est important que chaque chanson soit constituée de différents trous et fissures qui forment autant d’espaces que les gens peuvent pénétrer pour laisser libre cours à leurs propres sentiments et à leur imagination.


Votre incapacité à écrire pour les autres connaît quelques exceptions. La plus importante étant vos collaborations avec la réalisatrice Claire Denis. Comment avez-vous travaillé à l’écriture de ces films, de Trouble Every Day à High Life ?
Claire et moi sommes de très bons amis, mais travailler avec elle n’a pourtant rien de confortable. À aucun moment Claire ne me communique son film et me demande de faire la musique. Trouble Every Day en est une bonne illustration. Claire nous a simplement dit que le film poserait la question de savoir pourquoi les gens ont besoin de se mordre quand ils font l’amour. Elle souhaitait explorer ce sujet, mais d’une manière très romantique. Et finalement, quand la musique a été posée sur le film, une véritable collision s’est produite entre de magnifiques cordes et des scènes, en réalité, d’une grande violence. Et ça marchait. Je crois que la collaboration fonctionne mieux lorsque la musique n’est pas inspirée par un script, des images ou le film le lui-même. Et travailler avec Claire a permis au groupe de progresser, en lui permettant de sortir de sa zone de confort et de se confronter à d’autres idées. Je crois vraiment en sa manière de regarder le monde. Elle y voit des choses que je ne vois pas, ou que je ne comprends pas. Ce n’est pas parce que vous voyez quelque chose que vous le comprenez d’ailleurs. Je m’astreins à essayer de découvrir ce que Claire voit, de comprendre sa manière d’appréhender les choses. Car les choses peuvent être excitantes, c’est souvent le cas avec Claire, et je ne les comprends pas pour autant. Un mystère demeure. Et ce même mystère est au cœur de cette tentative de comprendre les émotions, les sons ou les choses.
Pour votre concert à la Fondation Cartier ce lundi 29 novembre, vous serez seul en scène avec un pianiste. Quels effets cela va-t-il avoir sur les morceaux que vous allez interpréter ?
Seuls quelques morceaux peuvent fonctionner avec cette approche si minimaliste. Je ne pourrais jamais interpréter l’intégralité du catalogue de Tindersticks dans ces conditions. Mais ce minimalisme permet d’explorer le sentiment de chaque chanson d’une manière différente. Il y a quelque chose de fragile à n’être que deux sur scène, moi à la voix et Dan au piano. Une autre forme de connexion avec le public se fait. Et cette connexion, vous ne pouvez jamais la prévoir avant de monter sur scène. C’est une alchimie à chaque fois différente. Vous devez vous offrir au moment et observer où il vous mène.
Réservez votre soirée du lundi 29 novembre avec Stuart A. Staples à la Fondation Cartier ici.